 Fidel Castro a souvent été blâmé pour l’état de l’économie cubaine, mais l’embargo américain de longue date et la question de savoir ce qui constitue un véritable succès économique rendent la question beaucoup plus complexe que cela, soutient Helen Yaffe.
Fidel Castro a souvent été blâmé pour l’état de l’économie cubaine, mais l’embargo américain de longue date et la question de savoir ce qui constitue un véritable succès économique rendent la question beaucoup plus complexe que cela, soutient Helen Yaffe.
A côté de sa représentation en tant que « dictateur brutal », les réflexions négatives sur Fidel Castro depuis sa mort en novembre 2016 se sont concentrées sur sa « mauvaise gestion » de l’économie cubaine et les « extrêmes de pauvreté » qui en découlent pour les Cubains ordinaires.
Cette caricature est problématique – non seulement parce qu’elle ignore l’impact économique dévastateur de l’embargo des États-Unis pendant 55 ans, mais aussi parce qu’elle est fondée sur des hypothèses économiques néoclassiques. Cela signifie qu’en mettant l’accent sur la politique économique plutôt que sur les restrictions économiques, les critiques peuvent rejeter la responsabilité de la prétendue pauvreté de Cuba sur Castro sans impliquer les administrations américaines successives qui ont imposé l’embargo étouffant.
Cette approche ignore également les questions clés concernant Cuba après la révolution. Où les pays à revenu moyen et faible peuvent-ils obtenir les capitaux nécessaires pour investir dans les infrastructures et les prestations sociales ? Comment obtenir des capitaux étrangers dans des conditions qui n’entravent pas ce développement, et comment un pays en retard de développement comme Cuba peut-il utiliser le commerce international pour produire un excédent dans une économie mondiale qui – beaucoup le prétendent – tend vers des « termes de l’échange inégaux » ?
C’est la recherche de solutions au défi du développement qui a conduit le gouvernement révolutionnaire de Cuba à adopter un système socialiste. Ils ont adopté une économie planifiée centralisée dans laquelle la propriété de l’État prédominait parce qu’ils percevaient ce système comme offrant la meilleure réponse à ces défis historiques.
Mais l’engagement de fonctionner dans un cadre socialiste impliquait des contraintes et des complications supplémentaires, en particulier dans le contexte d’un monde bipolaire. Mon livre, Che Guevara : The Economics of Revolution, examine les contradictions et les défis auxquels était confronté le gouvernement révolutionnaire naissant du point de vue du rôle de Guevara en tant que président de la Banque nationale et ministre des industries.
La littérature sur Cuba est dominée par la « cubanologie », une école académique au cœur de l’opposition politique et idéologique au socialisme cubain. Son émergence et ses liens avec le gouvernement américain sont bien documentés. Ses arguments sont que la révolution a tout changé à Cuba – et Fidel (puis Raul) Castro ont personnellement dominé la politique intérieure et étrangère depuis lors, niant la démocratie cubaine et réprimant la société civile. Grâce à leur mauvaise gestion de l’économie, la croissance depuis 1959 a été négligeable. Ils ont simplement remplacé la dépendance à l’égard des États-Unis par une dépendance à l’égard de l’URSS jusqu’à son effondrement en 1990.
Ces idées ont également façonné le discours politique et médiatique sur Cuba. Mais le problème de cette analyse est qu’elle obstrue notre capacité à voir clairement ce qui se passe à Cuba ou à expliquer l’endurance de la révolution et la vitalité de la société cubaine.
De quoi Castro a-t-il hérité ?
Les arguments sur le succès ou l’échec de l’économie post-1959 sont souvent suspendus à l’état de l’économie cubaine dans les années 1950. Le gouvernement post-1959 a hérité d’une économie dominée par le sucre avec les profondes cicatrices socio-économiques et raciales de l’esclavage. Le cubanologue Jaime Suchlicki affirme que le Cuba de Batista était « bien engagé dans ce que Walter Rostow a qualifié de phase de décollage », tandis que Fred Judson souligne les faiblesses structurelles de l’économie cubaine : « Des crises à long terme caractérisaient l’économie, dont la prospérité était superficielle et transitoire. » Ainsi, alors qu’un camp insiste sur le fait que la révolution a interrompu une croissance capitaliste saine, l’autre estime qu’elle était une condition préalable à la résolution des contradictions faisant obstacle au développement en mettant fin à l’asservissement de Cuba aux besoins du capitalisme américain.
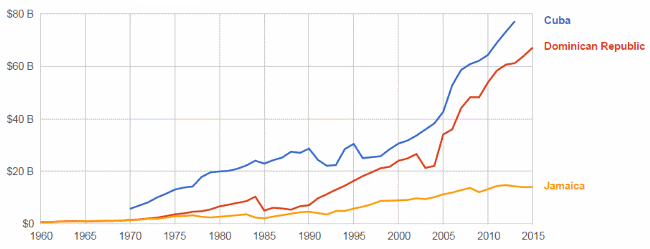
Après la révolution, Castro a entrepris d’apporter le bien-être social et la réforme agraire au peuple cubain et de confisquer les gains mal acquis de l’élite cubaine. Mais lorsque Fulgencio Batista, vaincu, et ses associés ont fui Cuba, ils ont volé des millions de pesos à la Banque nationale et au Trésor. Le pays est décapitalisé, ce qui limite fortement la capacité de dépenses publiques et d’investissements privés. Les Cubains fortunés quittent l’île, emportant avec eux leurs dépôts et leurs impôts. Comment le nouveau gouvernement allait-il mener à bien les ambitieuses réformes socio-économiques sans ressources financières ?
Il faut tenir compte de ces circonstances réelles à chaque instant. Par exemple, lorsque l’embargo américain a été mis en œuvre, 95 % des biens d’équipement de Cuba et 100 % de ses pièces de rechange étaient importés des États-Unis – et les États-Unis étaient, dans leur grande majorité, le principal destinataire des exportations cubaines. Lorsque le bloc soviétique s’est désintégré, Cuba a perdu 85% de son commerce et de ses investissements, ce qui a entraîné une chute de 35% du PIB. Ces événements ont produit de sérieuses contraintes économiques sur la marge de manœuvre de Cuba.
Mettre un prix sur la pauvreté
Poursuivant, nous devrions également nous demander : comment devons-nous mesurer la pauvreté de Cuba ? Est-ce le PIB par habitant ? Est-ce le revenu monétaire par jour ? Devons-nous appliquer les critères de l’économie capitaliste, en nous concentrant sur les statistiques de croissance et de productivité pour mesurer le « succès » ou l' »échec », tout en accordant peu d’attention aux priorités sociales et politiques ?

Même en tenant compte de son faible PIB par habitant, l’indice de développement humain (IDH) classe Cuba dans la catégorie « développement humain élevé » ; il excelle non seulement en matière de santé et d’éducation, mais aussi en matière de participation des femmes et d’inclusion politique. Cuba a éliminé la malnutrition infantile. Aucun enfant ne dort dans la rue. En fait, il n’y a pas de sans-abri. Même pendant les années de crise économique des années 1990, les Cubains ne sont pas morts de faim. Cuba s’en est tenu à l’économie planifiée, et cela leur a permis de rationner leurs maigres ressources.
Oui, les salaires sont extrêmement bas (comme l’ont déploré Fidel et Raul) – mais les salaires des Cubains ne déterminent pas leur niveau de vie. Environ 85% des Cubains sont propriétaires de leur logement et le loyer ne peut dépasser 4% du revenu d’un locataire. L’État fournit un panier alimentaire (très) basique, tandis que les factures de services publics, les frais de transport et les médicaments sont maintenus à un faible niveau. L’opéra, le cinéma, le ballet, etc. sont bon marché pour tous. L’éducation et les soins de santé de haute qualité sont gratuits. Ils font partie de la richesse matérielle de Cuba et ne doivent pas être écartés – comme si la consommation individuelle de biens de consommation était la seule mesure du succès économique.
Opération miracle
Les défis spécifiques et réels auxquels le développement cubain a été confronté a généré des contradictions uniques. Dans une économie planifiée, avec un budget extrêmement serré, ils ont dû établir des priorités : l’infrastructure s’effrite et pourtant ils ont des indicateurs de développement humain du premier monde. Le taux de mortalité infantile est très révélateur du niveau de vie, car il est influencé par de multiples facteurs socio-économiques et médicaux. Le taux de mortalité infantile de Cuba est de 4,5 pour 1 000 naissances vivantes, ce qui le place parmi les pays du premier monde – et au-dessus des États-Unis selon le propre classement de la CIA.
Les Cubains ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de ces investissements. Des dizaines de milliers de médecins, d’éducateurs et d’autres agents d’aide au développement cubains ont servi dans le monde entier. Actuellement, quelque 37 000 médecins et infirmiers cubains travaillent dans 77 pays. Ils génèrent des devises étrangères d’environ 8 milliards de dollars par an – la plus grande exportation de Cuba.
En outre, Cuba fournit à la fois un traitement médical gratuit et une formation médicale gratuite à des milliers d’étrangers chaque année. Initiative directe de Fidel, en 1999, l’École latino-américaine de médecine a été inaugurée à La Havane pour offrir aux étudiants étrangers des pays pauvres six ans de formation et un logement entièrement gratuits. En 2004, Cuba s’est associée au Venezuela pour offrir des opérations ophtalmologiques gratuites aux habitants de trois douzaines de pays dans le cadre de l’opération « Miracle ». Au cours des dix premières années, plus de 3 millions de personnes ont retrouvé la vue.

Interdisant même le commerce des médicaments, l’embargo américain a conduit Castro à donner la priorité aux investissements dans les sciences médicales. Cuba possède aujourd’hui environ 900 brevets et commercialise des produits pharmaceutiques et des vaccins dans 40 pays, générant des revenus annuels de 300 millions de dollars US, avec un potentiel d’expansion massive. Le secteur produit plus de 70% des médicaments consommés par ses 11 millions d’habitants. L’ensemble de l’industrie appartient à l’État, les programmes de recherche répondent aux besoins de la population et tous les excédents sont réinvestis dans le secteur. Sans la planification et les investissements de l’État, il est peu probable que cela ait pu être réalisé dans un pays pauvre.
Au milieu des années 1980, Cuba a développé le premier vaccin contre la méningite B au monde. Aujourd’hui, elle est leader dans les médicaments oncologiques. En 2012, Cuba a breveté le premier vaccin thérapeutique contre le cancer. L’embargo américain oblige Cuba à s’approvisionner en médicaments, dispositifs médicaux et produits de radiologie en dehors des États-Unis, ce qui entraîne des coûts de transport supplémentaires.
Économie de partage
Le président de l’Équateur, Rafael Correa, me disait en 2009 :
Un grand exemple fourni par Cuba est que dans sa pauvreté, il a su partager, avec tous ses programmes internationaux. Cuba est le pays qui a la plus grande coopération par rapport à son produit intérieur brut et c’est un exemple pour nous tous. Cela ne signifie pas que Cuba n’a pas de gros problèmes, mais il est également certain qu’il est impossible de juger du succès ou de l’échec du modèle cubain sans tenir compte du blocus américain, un blocus qui dure depuis 50 ans. L’Équateur ne survivrait pas cinq mois avec ce blocus.
Prenons l’embargo : le gouvernement cubain estime qu’il a coûté à l’île 753,69 milliards de dollars américains. Leur rapport annuel aux Nations unies fournit un compte rendu détaillé de ce calcul. C’est beaucoup pour un pays dont le PIB moyen entre 1970 et 2014 a été calculé à 31,7 milliards de dollars US.
Oui, Castro a présidé à des erreurs et des fautes dans l’économie planifiée de Cuba. Oui, il y a la bureaucratie, la faible productivité, la crise de liquidité, la dette et de nombreux autres problèmes – mais où ne sont pas les problèmes ? Castro a souligné ces faiblesses dans ses propres discours au peuple cubain. Mais le président Correa a raison – pour juger objectivement l’héritage de Castro, le développement cubain et les réformes contemporaines aujourd’hui, nous ne pouvons pas prétendre que le blocus américain – qui subsiste aujourd’hui malgré le rapprochement – n’a pas façonné l’économie cubaine.
Castro a failli voir 11 présidents américains depuis 1959, mais il n’a jamais vécu pour voir la fin de l’embargo américain. De nouveaux défis attendent Cuba, avec les réformes économiques en cours et le rétablissement des relations avec les États-Unis. La prochaine étape, y compris pour moi personnellement, est d’évaluer la résilience de la révolution cubaine dans cette ère post-Castro et Donald Trump.
